Au commencement de la guerre, Pierre Bernard habite rue Levot chez ses parents. Il y a passé son enfance. Après son baccalauréat, il s’inscrit à la Faculté de médecine de Rennes, en même temps que son voisin et camarade de lycée Jean Bizien, de la rue Kerivin. Dans les périodes de congés et de vacances annuelles, ensemble ou séparément les deux jeunes hommes reviennent sur Brest.
Après l’invasion complète du pays par la Wehrmacht, en novembre 1942, ils s’interrogent sur la conduite qu’ils doivent adopter pour combattre à leur manière. Ils se promettent d’entrer en résistance, sans savoir trop comment. Bernard fait le premier pas, sans doute à l’occasion d’un retour en famille lors des fêtes de fin d’année. Ayant dans ses relations Georges Dauriac, membre de Défense de la France (D.F), il accepte de servir ce mouvement. Jean Bizien le suit à la fin mars 1943, encouragé par un autre Brestois, Jacques Boulaire également à l’œuvre depuis quelques semaines avec Dauriac.
Première tâche : assurer la diffusion des tracts et journaux de propagande imprimés clandestinement. Ils leur sont apportés de Paris par Jean Senellier qui, étudiant comme eux, est invité par ses chefs à augmenter en Bretagne le nombre de leurs lecteurs. C’est ainsi que, de proche en proche, de relais en relais, de Brestois peu impliqués dans la Résistance mais sympathisants en Brestois qui le sont davantage, Bernard en vient à être orienté vers Pierre Jeanson, du réseau Jade. Franchissant un degré supplémentaire dans l’engagement contre l’ennemi, sa seconde tâche est maintenant de collecter le maximum d’informations stratégiques pour qu’elles soient transmises à l’Intelligence Service et servent à la conception des plans d’attaques aériennes et maritimes.
S’il n’y avait pas le sérieux des investissements personnels, la situation pourrait être jugée cocasse. En août 1943, Bernard et Jean Bizien sont priés de se soumettre au Service de Travail Obligatoire (STO), mais en raison de leur cursus universitaire les voici affectés en duo dans un service médical requis par la Wehrmacht et la Kriegsmarine, afin de dépister chez les prostituées brestoises qui veillent au repos des guerriers ennemis d’éventuelles maladies vénériennes. Les voici donc exerçant au laboratoire d’analyses bactériologiques installé dans la rue Traverse un ingrat travail de prévention et de signalement. Sauf qu’ils en profitent pour interroger ces femmes sur les circonstances des rapports tarifés qu’elles ont chaque jour, sur ce que racontent leurs clients, sur les confidences qu’ils lâchent entre deux chopes de bière ou entre deux soupirs horizontaux. De bavardages en bavardages, tant certains sont prolixes, il devient alors facile de rassembler des informations de grand intérêt sur le mouvement des navires et les activités de l’Arsenal.
En particulier, lorsque, retour de campagnes, des sous-mariniers racontent leurs exploits, elles s’en font l’écho. Nos jeunes carabins se donnent des airs absents, mais ne manquent pas une miette. Bernard répercute le tout à un intermédiaire qui en réfère à Jeanson, et l’astuce se prolonge. Rien n’est à négliger. Parmi les officiers de la Kriegsmarine ayant intercepté des bâtiments alliés, « beaucoup s’épanchaient en galante compagnie et nous permettaient d’enregistrer les pertes. La venue secrète d’un sous-marin japonais transportant des minerais rares nous fut révélée par cette voie, les équipages s’étant détendus dans des lieux hospitaliers », explique Pierre Hentic. Et Jean Bizien de fournir les détails qui lui sont restés en mémoire : frottis, plaquettes, microscopes, confidences d’apparence banale, bonjour bonsoir, rapports ensuite à qui de droit, et surprise d’apprendre même encore après la guerre l’importance de certains secrets lâchés dans des positions chères au Kamasoutra, comme précisément celui relatif au sous-marin japonais reparti de Bretagne au début d’octobre avec un précieux chargement de tungstène et d’étain.
Des témoignages tardifs prêtent à Bernard d’avoir organisé un corps franc d’action directe dès la fin 1942 pour le compte de Défense de la France. Le fait se discute pour deux raisons au moins. La première est que l’indication chronologique ne peut convenir. Elle anticipe sur des événements qui lui sont postérieurs, et rien ne permet d’affirmer que Bernard y prend une part active. C’est au printemps 1943 que la branche paramilitaire du mouvement se manifeste, sous l’impulsion de Dauriac, suite aux premiers contacts établis pour la diffusion des journaux. Et Bernard est encore à Rennes où il a un petit appartement impasse de la Vigne. La seconde raison est que Jade interdit formellement à chacun de ses agents d’exercer une activité qui, en dehors des renseignements, pourrait les exposer à des risques supplémentaires. Il faut attendre la fin de l’hiver 1943-1944, avec les arrestations subies par le réseau, pour que Bernard reporte son énergie dans le groupe de son ami Dauriac. Entre temps, il a abandonné ses études.
Dauriac est un chef opérationnel. Il se fie à ses intuitions ou à des indications venues par la bande, pour décider de certains coups, entre autres pour lancer des attaques ou des cambriolages nocturnes de mairie. Ces actions permettent de récupérer des documents administratifs et des tampons servant à la fabrication de faux papiers, ou pour s’emparer de tickets de ravitaillement nécessaires à la fourniture de vivres aux réfractaires du STO. Bernard assure plutôt les prises de contact extérieures à Brest en vue d’augmenter l’influence de Défense de la France dans les communes rurales des environs. Il transporte par ailleurs, entre Brest et Paris, une grande partie du butin dérobé dans les mairies. Quand il rentre de voyage, il communique les ordres reçus des chefs du mouvement qui envisagent une coordination nationale et régionale de tous les groupes entre eux, mais aussi avec d’autres mouvements de même envergure. Ce sont des ordres généraux qui ne peuvent pas tenir compte de l’évolution rapide des conjonctures locales, lesquelles réclament des initiatives plus de la part de Dauriac que de la sienne.
Dans la nuit du 26 au 27 avril 1944, passé minuit, survient un incident majeur. Place de la Liberté, plusieurs volontaires de Défense de la France se trouvent confrontés à une patrouille. Une fusillade s’ensuit. Plus tard, la rumeur assurera que la patrouille était allemande et que quatre résistants furent blessés. Simone Camus (née Le Saoût) dira quant à elle que ce sont des policiers français qui auront provoqué l’affrontement. La vérité admet ces deux possibilités. Il y a eu des Français et des Allemands. Encore doit-on reproduire assez fidèlement les circonstances, en croisant les sources, celles de la police produites au moment des faits et celles ultérieures des témoins directs ou indirects.
Tout commence en effet par un banal contrôle de routine. Trois gardiens cyclistes de notre maréchaussée brestoise sont en train de faire leur ronde place de la Liberté, avec l’intention de remonter la rue Jean-Jaurès et de se reposer au poste de Saint-Martin. Soudain, ils aperçoivent trois personnes qui, sortant d’un terrain vague bordant le théâtre municipal, au mépris des consignes de couvre-feu, viennent dans leur direction. Ils allument leurs lampes électriques, sortent leurs revolvers de leurs étuis, et font les sommations d’usage. Halte Police ! Haut les mains ! Trois contre trois, l’équation est équilibrée.
La fouille commence. Premier résultat : un gardien trouve un pistolet automatique sur son vis-à-vis. Fabrication espagnole, chargeur au complet. Second résultat : un autre chargeur est sorti des poches du noctambule à côté. Puis, de celles du troisième, ce sont deux boîtes de cartouches allemandes qui apparaissent comme par enchantement. La question à ne pas poser, mais qu’un gardien pose quand même, est de savoir ce que font les trois gaillards avec un tel équipement. La réponse est : « Attendez, vous allez comprendre ».
Ils comprennent. Deux autres groupes passent à proximité, l’un se met un peu en hauteur, l’autre contourne vers le bas. Le temps de viser, et la première détonation claque. Un gardien, touché au mollet, s’écroule. L’un de ses collègues réplique sur le champ. La fusillade prend alors une allure de mauvais western. Les torches électriques ayant été éteintes, réflexe salutaire, les balles sifflent de tous côtés. Riposte, contre riposte. Deux minutes ainsi. Et puis des marins de la Kriegsmarine alertés par les bruits manifestent également leur curiosité. Ils dégainent. Le feu roule. Finalement, l’obscurité a ceci d’avantageux qu’elle permet aux clandestins de s’échapper, et aux sergents de ville de s’en tirer avec les honneurs. Le seul blessé dans leurs rangs est l’homme au mollet percé. Les marins ? rien non plus.
Il y avait en tout huit garçons de Défense de la France sur les lieux. Le compte est facile à établir. Les trois interpellés, trois encore dans le premier groupe d’encerclement, puis deux dans le second. Quelques uns ont été touchés. Peut-être quatre, si l’on en croit Yves Hall. Le plus en danger est François Laot. Tant bien que mal, les autres parviennent à le ramener chez lui, en passant par la rue Yves Collet. « Il est arrivé là, et Yves Hall a dit qu’il allait chercher un docteur. En pleine nuit, il est parti chercher le docteur Barbaro », expliquera Jacques Boulaire en 1957. On ne parle jamais de ce praticien de la rue du Château, prénommé Gabriel, qui vient extraire les balles. Autant que son collègue Roger Phélippes de la Marnierre, il lui est déjà arrivé de soigner des patriotes qui, par la force des choses, ne pouvaient pas se rendre dans un hôpital.
Pour le reste du groupe, le répit est de courte durée. Le 30 avril, une tentative de mettre à sac l’appartement d’un officier de la Kriegsmarine, rue de la Vierge, échoue. Le maître des lieux chasse les intrus. Oui mais, l’enquête diligentée à la fois par la police brestoise et la Gestapo, dont les locaux sont à l’école de Bonne-Nouvelle, conduit à des interpellations et interrogatoires violents. De fil en aiguille, les officiers de la sécurité allemande se mettent en piste. Ils touchent au but le 4 mai. Plusieurs responsables de Défense de la France sont neutralisés au même moment, dont Pierre Bernard.
Nul ne sait qui est à l’origine de ce démantèlement. Autant qu’on puisse établir une synthèse cohérente à partir des témoignages divergents, une première victime est Françoise Elie, qui tient une épicerie place du Carthage à Rennes. Le 3 mai, un officier subalterne de la Gestapo (Untersturmführer), Friedrich Fischer, fait irruption chez elle. Il a été informé qu’une réunion importante aura lieu le lendemain dans sa boutique. Son intention est donc d’inspecter les lieux afin de préparer un traquenard. En effet, quatre hommes s’y sont donné rendez-vous Jacques Boulaire, Pierre Bernard, Pierre Héger et Maurice Prestaut.
Héger est né à Brest le 10 avril 1912, il enseigne les sciences naturelles à Saint-Brieuc. Depuis peu, il exerce des responsabilités régionales pour Défense de la France, ce qui l’amène à revenir souvent dans sa ville natale où il loge chez ses parents, 16 rue de Gasté. Il connaît très bien Boulaire, et a été à l’école le condisciple de Giselle Inisan, fille d’un représentant mandataire de la marine, rue Victor-Hugo, future madame Dauriac. Prestaut est un ancien officier marinier, qui a pris la succession de Sennelier (arrêté le 27 juillet 1943) aux fonctions de délégué national pour resserrer la liaison entre Paris et Brest. Il séjourne de plus en plus souvent à Rennes où il occupe le bureau de l’assistante médicale scolaire de la ville, aussi membre du mouvement, afin d’y planifier ses actions.
Sauf pour Prestaut qui en réchappe, le piège fonctionne. Comme Boulaire et Bernard, tous deux en provenance de Brest, ont dans leurs bagages des armes, de l’argent provenant de parachutages anglais et des tickets d’alimentation emportés de la mairie de Ploudalmézeau, il leur est difficile de feindre l’innocence. Sont-ils torturés ? Ne le sont-ils pas ? Après la guerre, Héger dira avoir vu Bernard en sang, ayant beaucoup de mal à tenir sur ses jambes. Jean Bizien ne sera pas de cet avis, qui reprochera au contraire à Bernard d’avoir conduit Fischer chez lui, sans aucune blessure apparente, et d’avoir ainsi facilité une arrestation de plus. Toujours est-il que lui-même est très férocement malmené. Après un internement à la prison Sainte-Margueritte et un transit au camp de Compiègne, leur déportation en Allemagne est programmée. Le 28 juillet, le train emporte Bernard vers la mort. Il disparaît le 31 mars 1945 au camp de Neuengamme, prisonnier n° 39355.
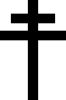 Mémoires des Résistants et FFI de l’arrondissement de Brest
Mémoires des Résistants et FFI de l’arrondissement de Brest